 Seize heures. C’est le milieu de l’après-midi, presque le début du soir. Sous les tropiques, la nuit
tombe tôt. Vers cinq heures et demi, quelle que soit la saison d’une latitude qui n’en connaît que deux : la chaude et sèche ou la chaude et mouillée.
Seize heures. C’est le milieu de l’après-midi, presque le début du soir. Sous les tropiques, la nuit
tombe tôt. Vers cinq heures et demi, quelle que soit la saison d’une latitude qui n’en connaît que deux : la chaude et sèche ou la chaude et mouillée.
Je souris en repensant à mes arrivées à Bangkok. A cette gifle d’étuve lorsque s’ouvrent les portes de l’aéroport. A chaque fois, les premières minutes, l’humidité brûlante m’étouffe, me forçant à ouvrir grand la bouche pour ne pas suffoquer. Inhalation brutale d’une saveur désormais familière, âcre mélange de sueur humaine, de gaz d’échappement et de caoutchouc brûlé.
Pour qui débarque d’Europe, l’air des tropiques est pire qu’un drap violemment rabattu. Il a la densité d’un vêtement trop lourd et serré, l’épaisseur de la fatigue d’une nuit sans sommeil. Cet air en étau aux mâchoires trop ajustées est l'étreinte qui signe mon retour à la maison.
Je traverse lentement la grande place. Ombragée d’un chapiteau et ouverte à la brise, elle a des airs de vacances en terrasse. Pourtant, personne ne musarde près de ses arcades. Personne, non plus, n’y est attablé. Déserte, elle est tranquille, si étrangement calme au milieu de cette ville trop bruyante.
La karenderia ou petit restaurant local est fermé. Les marmites trônant d’habitude sur le comptoir de bois ont été rangées. Lorsqu’elles sont pleines, on en soulève les couvercles sous l’œil de la cuisinière qui, selon les goûts de chacun, recommandera ceci plutôt que cela.
Un regard aux mets et on fait son choix.
Le frigo n’est pas utilisé pour stocker les plats. Cuisinés au matin, ils restent toute la journée dehors et sont servis froids. L’ambiance est comme les récipients en plastique, chaleureuse et sans chichis, à la bonne franquette d’une table pas franchement propre et d’un sol parsemé de détritus.
Un coup d’éponge, un coup de balai et hop, il n’y paraîtra plus.

Encore quelques pas pour laisser le chapiteau dans mon sillage.
Je m’arrête.
Réflexologie plantaire, clame la pancarte de toutes ses majuscules.
C’est bien là que Bertille m’a emmenée il y a quelques mois. Je reconnais la porte branlante et l’affiche au pied malhabilement dessiné. Sa plante ressemble à deux oranges écrasées, ses orteils à des huîtres collées sur un rocher. Punaisé en dessous, un panneau récapitule les horaires de travail.
Samedi. Fermeture à 21 heures.
Moi qui craignais de me heurter à une porte close, me voilà rassurée.
J’entre. Depuis la dernière fois, rien n’a changé. L’air est toujours aussi moite en dépit du ventilateur turbinant à plein régime, la pièce aussi petite, le mobilier aussi usé.
Construite jusqu'à mi-hauteur, une cloison s’orne d’une moustiquaire. Le fin grillage découpe au cordeau la pièce attenante. Des hommes y vont et viennent mais la plupart, assis en duos, ne bougent pas d’un pouce. Parfois rompu par un rire vite réprimé, le silence est recueilli, l’atmosphère studieuse.
Je plisse les sourcils. Mais que font-ils donc là-dedans, tous ?
Je me promets de vérifier en sortant, et jamais n’aurais deviné que, concentrés, passionnés, ces hommes jouent. Aux échecs.
 La patronne s'arrache de son livre de compte. Me souhaite la bienvenue en visayan. S’enquiert de ce que je
désire.
La patronne s'arrache de son livre de compte. Me souhaite la bienvenue en visayan. S’enquiert de ce que je
désire.
Je lui désigne mes pieds et elle, une des chaises en plastique.
J’y attends mon tour en sortant de mon sac le nécessaire à massages. Une petite serviette rose, une bouteille d’huile, un flacon d’alcool.
Chaque nouveau client peut l’acheter au salon contre une somme modique. Revenir avec autant de fois qu’il le désire.
Dans cet établissement, rien n’est fait pour pousser à la consommation. On réutilise, remplit, recycle au lieu de jeter.
D’ailleurs, aucune employée, une fois sa tâche achevée, n’insistera pour vous vendre un autre service. Un massage du dos alors que vous préférez en rester aux pieds. Un massage des pieds alors que vous souffrez du dos.
Encadrés sur le mur d'en face, des clichés aux couleurs passées. L’équipe de la patronne en rang d’oignon, debout, souriante, un peu guindée façon photo de classe, quand on prend, gênés, une pose maladroite.
Les légendes indiquent : sixième, septième, huitième anniversaire.
Le lieu a vieilli au même rythme que ses occupantes. Et, en dépit des coups d’éponge et de balai, dégage toujours une impression d’à peu près. Même propre, il paraît douteux, mais se fier à sa mine serait une erreur. S’il est complet, c’est que les masseuses y sont excellentes.
La mienne est une femme d’âge mûr, aux cheveux grisonnants tirés en queue-de-cheval. Quand elle sourit, le réseau de ses rides lui dessine un deuxième visage.
Je ne la reconnais pas mais elle, si. Comme sa collègue qui, aussitôt, me demande des nouvelles de Bertille.
- Elle va bien, dis-je.
 La conversation roule, décousue, heurtée, souvent interrompue.
La conversation roule, décousue, heurtée, souvent interrompue.
Depuis quand suis-je sur l’île ?
Où se trouve ma maison ?
Bertille vit-elle avec moi ?
Ai-je un homme dans ma vie ?
En suis-je amoureuse ?
Ces questions de plus en plus indiscrètes m’amusent.
Peu d’étrangers, peut-être même aucun, ne fréquente ce salon. Il est trop à l’écart, trop défraîchi, trop peu engageant pour attirer les touristes.
Du coup, une « puti » - une blanche - ne peut que susciter la curiosité. Ce qui paraîtrait offensant en France ne l’est d’ailleurs pas aux Philippines, où les territoires de l’intime, leur contenu et leurs limites ne se dessinent pas à l’identique.
- Pourquoi n’as-tu pas d’enfants ? est dans ce pays orienté famille une question normale.
- Mais tu as toujours tes règles, non ? n’a rien d’une impolitesse.
- Dans ce cas, parfait ! Tous les espoirs sont permis ! tient lieu de sincère encouragement, presque de soulagement.
Ces femmes à la tête de familles nombreuses, souvent très jeunes à la naissance de leur premier bébé, ne peuvent se figurer une vie sans enfants.
L’identité de femme passe ici par celle d’épouse et de mère, du regard porté sur soi par les autres jusqu’aux formulaires officiels. Médecins, hôpitaux, agences de voyages, bureaux de l’immigration… Partout, toujours, les fiches à remplir comportent la rubrique statut : mariée, veuve, célibataire. Rarement divorcée, puisqu’aux Philippines, le divorce n’existe pas.
 A la discussion très vite tout le monde se mêle. Patronne, employées, clients, chacun y va de son avis, de son conseil,
de son grain de sel.
A la discussion très vite tout le monde se mêle. Patronne, employées, clients, chacun y va de son avis, de son conseil,
de son grain de sel.
Ca papote, ça caquète, ça rigole sans méchanceté aucune, juste pour le plaisir d’échanger, commenter, surenchérir.
Il y a dans toute cette agitation un côté si bon enfant, une franchise parfois si naïve qu’il est difficile de s’en offusquer.
C’est la simplicité qui prime et règne, des questions personnelles aux rots sonores que personne n’étouffe.
En attendant, de digressions en éclats de rire, la masseuse travaille sur mes pieds.
- Sakit ! Sakit ! (Ca fait mal !)
Chacune de mes protestations me vaut un regard aussi compatissant que malicieux.
- And here ?
- Sakit !
Entrée dans ce salon fourbue, j’en ressors à la nuit noire, chaussée de semelles de vent.
Dans la boîte à pourboire j’ai glissé un gros billet.
C’est bientôt leur neuvième anniversaire.
Photos : Roman Signer, Bill Brandt, Elmer Batters,
Cornell Capa, Richard Avedon.























 La sorcière me tendit sa lanterne en m’ordonnant de prendre un bonbon.
La sorcière me tendit sa lanterne en m’ordonnant de prendre un bonbon.
 Puis, à mesure de mon installation imprévue, j’eus envie.
Puis, à mesure de mon installation imprévue, j’eus envie.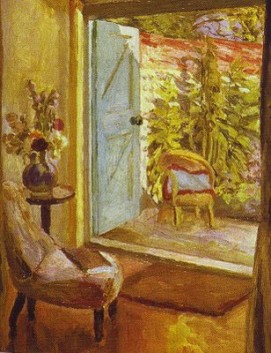 La première fois que je
me rendis chez Bertille, j'avais très mal aux dents. Assise derrière mon instructeur, secouée comme un pépin dans un shaker, je me demandais où menait ce chemin défoncé d'ornières et raviné de
pluie. Tim stoppa devant un haut portail blanc.
La première fois que je
me rendis chez Bertille, j'avais très mal aux dents. Assise derrière mon instructeur, secouée comme un pépin dans un shaker, je me demandais où menait ce chemin défoncé d'ornières et raviné de
pluie. Tim stoppa devant un haut portail blanc.

 L'heure que nous appelons "l'heure de la boule", quand la musique de
notre bar préféré monte en intensité et que la boule à facettes du plafond se met à tournoyer, éclaboussant les consommateurs de faisceaux rouges, verts, jaunes.
L'heure que nous appelons "l'heure de la boule", quand la musique de
notre bar préféré monte en intensité et que la boule à facettes du plafond se met à tournoyer, éclaboussant les consommateurs de faisceaux rouges, verts, jaunes. - J'ai l'impression d'être dans une machine à laver, dis-je. Programme rapide, secouée avant essorage, sans trouver le bouton
d'arrêt.
- J'ai l'impression d'être dans une machine à laver, dis-je. Programme rapide, secouée avant essorage, sans trouver le bouton
d'arrêt. Je lui demande de déplacer son ordinateur. La lumière blanche déversée par sa fenêtre m'éblouit trop. Et j'ai trop mal à la tête, à la gorge, à l'oreille pour
garder les paupières plissées.
Je lui demande de déplacer son ordinateur. La lumière blanche déversée par sa fenêtre m'éblouit trop. Et j'ai trop mal à la tête, à la gorge, à l'oreille pour
garder les paupières plissées. Je lui parlai aussi de ma violence, qui suit ma colère de si près qu’elle se confond presque avec elle. De ma capacité à
tout envoyer promener sur un coup de tête. De mes réflexes de défense bien huilés.
Je lui parlai aussi de ma violence, qui suit ma colère de si près qu’elle se confond presque avec elle. De ma capacité à
tout envoyer promener sur un coup de tête. De mes réflexes de défense bien huilés. Ton visage tiré est pâle. Venue de ta fenêtre, la lumière très blanche m’éblouit,
averse en coulée immaculée m’obligeant à froncer les yeux. Elle dessine un halo autour de ta tête brune et j'ai l’impression de voir un ange. Un ange aux ailes repliées, aux cheveux ras, à la
barbe naissante perché sur un canapé crème.
Ton visage tiré est pâle. Venue de ta fenêtre, la lumière très blanche m’éblouit,
averse en coulée immaculée m’obligeant à froncer les yeux. Elle dessine un halo autour de ta tête brune et j'ai l’impression de voir un ange. Un ange aux ailes repliées, aux cheveux ras, à la
barbe naissante perché sur un canapé crème. Ces sensations étranges n'arrivèrent pas tout de suite. Il y eut en préludes la complicité, l’émotion, les fous rires, puis ta venue dans ma
maison.
Ces sensations étranges n'arrivèrent pas tout de suite. Il y eut en préludes la complicité, l’émotion, les fous rires, puis ta venue dans ma
maison.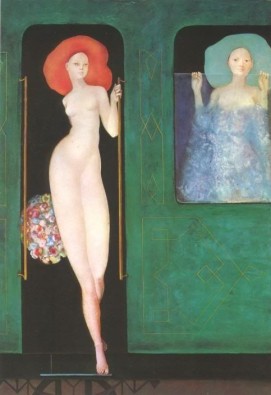 Tu me dis que tu dois raccrocher.
Tu me dis que tu dois raccrocher.
Paroles de lecteurs