 Parce que
certains jours, je tourne chez moi comme une bête encagée puis ouvre la porte qui me'emprisonne pour m'échapper.
Parce que
certains jours, je tourne chez moi comme une bête encagée puis ouvre la porte qui me'emprisonne pour m'échapper.
Parce que certains soirs, je mords les oreillers à m'en étouffer puis crache leur bourre pour respirer enfin.
Parce que certaines nuits, je regarde le vide sous ma fenêtre puis lève les yeux en pensant que c'est beau, la nuit.
Parce que le lendemain venu, je pense au lendemain.
Parce que Sven m'a écrit :
"Pour t'avoir vue heureuse j'ai envie de te dire de rester entière, humaine,
écorchée... Celui qui souffre est celui qui vit."
Parce que toi, Ether, tu as eu cette phrase qui parmi mille m'a marquée :
- Je suppliais mes amies qu'elles me coupent les mains pour ne pas le rappeler.
Parce que je pense que mes mains ont mieux à faire qu'être coupées. Elles peuvent encore servir.
Parce qu'un après-midi, Marianne, une amie de trente ans, m'a affirmé que j'étais "une survivante" et que j'ai répondu :
- Non, je suis vivante !
Et que je me suis levée pour faire l'amour ou croquer dans un fruit bien mûr, le menton dégoulinant de jus sucré.
Parce qu'il y a des lustres, Hervé, un amant dont j'étais toquée, m'a glissé lors de notre ultime rendez-vous :
- L'oubli est la condition de la nature humaine. Heureusement qu'il existe. Sinon nous deviendrons tous fous.
Cet homme avait perdu sa femme, fauchée par un camion sur l'autoroute.
J'étais trop jeune pour comprendre sa douleur.
 Parce qu'un soir, j'ai confié à Paulien :
Parce qu'un soir, j'ai confié à Paulien :
- L'amour, c'est te dire que j'aime celle que je suis avec toi. Là, j'ai envie de te dire que je t'aime parce que tu me rends meilleure.
Je pensais alors incapable de lui pardonner, à cet autre tant aimé me condamnant à me sentir si petite et minable.
C'était en partie de ma faute.
Parce qu'au fil des jours j'ai soutenu sans mentir :
- J'ai déjà plongé dans mon enfer et de cet enfer je suis revenue. Ce n'est donc pas ça qui m'abattra !
Parce que j'ai un putain d'orgueil, qu'il y a d'autres voyages qui m'attendent, des avions à prendre, le
monde à embrasser, d'autres hommes à étreindre.
Peut-être même un enfant à faire avec un que j'aimerais de mes tripes.
En attendant, je l'avoue, je dérouille.
Parce que cet homme-là, il était loin d'être n'importe qui. Mais je m'aime plus que je ne l'aime, lui.
Sinon je ramperais à ses pieds en le suppliant de m'accorder les bribes d'une affection qu'il a bien voulu me garder.
De ces miettes je ne veux pas. J'ai mieux à offrir que la face terne de la médaille.
Mon corps peut jouir encore et que je peux rire de tout, à commencer de moi-même.
Jamais, je me le souhaite, je ne deviendrai une vieille femme aigrie résumée à ses blessures et ses regrets, incapable
d'écrire comme lui jadis :
"Je leur laisse leur raison, je garde mes rêves. Je préfère mourir malheureux que de vivre en étant vide. Et s'il y a une vie après la mort, on verra bien qui, de moi ou eux, sera le plus chiant
à table."
Si un jour je deviens la plus chiante à table, ce jour-là, j'aurai suffisamment vécu.





















 La
première fois que j'ai vu Feu mon amour, je ne l'ai pas trouvé beau.
La
première fois que j'ai vu Feu mon amour, je ne l'ai pas trouvé beau.

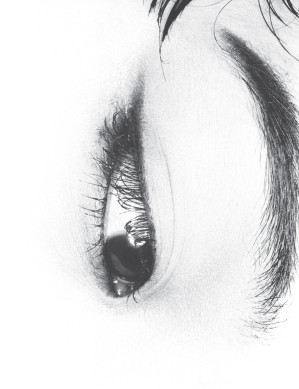 Un jo
Un jo
 - Il faut que je te parle,
rappelle-moi.
- Il faut que je te parle,
rappelle-moi. Tu as envie d'être là pour moi comme moi, je le suis pour toi ?
Tu as envie d'être là pour moi comme moi, je le suis pour toi ? Quand le réservoir d'essence fut vide,
l'aiguille du compteur entra dans la zone rouge : celle de la réserve. Le carburant allait manquer, c'était une évidence. Seul restait l'espoir qu'il m'en resterait assez pour arriver au bout de la
route.
Quand le réservoir d'essence fut vide,
l'aiguille du compteur entra dans la zone rouge : celle de la réserve. Le carburant allait manquer, c'était une évidence. Seul restait l'espoir qu'il m'en resterait assez pour arriver au bout de la
route. Le mode Terminator est robotique, proche du végétatif. Il se résume aux besoins
fondamentaux du corps, à un mode de communication ultra basique entre soi et soi, mais avec signaux brouillés : la douleur est tellement permanente, omniprésente qu'on ne sait ni d'où elle vient,
ni comment la stopper.
Le mode Terminator est robotique, proche du végétatif. Il se résume aux besoins
fondamentaux du corps, à un mode de communication ultra basique entre soi et soi, mais avec signaux brouillés : la douleur est tellement permanente, omniprésente qu'on ne sait ni d'où elle vient,
ni comment la stopper.
 C'est l'histoire d'un trou qui
s'agrandit. D'une faille qui se creuse. Et on voit le trou s'agrandir, la faille se creuser sans être capable de faire quoi ce soit pour les en empêcher.
C'est l'histoire d'un trou qui
s'agrandit. D'une faille qui se creuse. Et on voit le trou s'agrandir, la faille se creuser sans être capable de faire quoi ce soit pour les en empêcher.
Derniers Commentaires