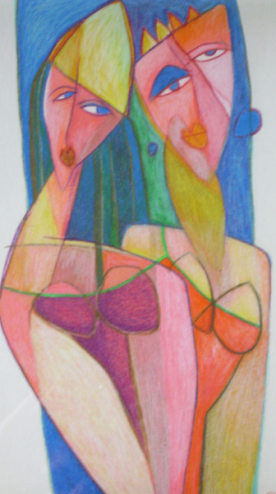 Kate fut parmi mes premières amies de troisième. Nous étions dans la même classe et elle habitait à côté du collège. Alors,
chaque matin, je faisais à peine un détour pour venir la chercher. Mais au lieu de monter chez elle, j'appuyais sur l'interphone afin qu'elle descende.
Kate fut parmi mes premières amies de troisième. Nous étions dans la même classe et elle habitait à côté du collège. Alors,
chaque matin, je faisais à peine un détour pour venir la chercher. Mais au lieu de monter chez elle, j'appuyais sur l'interphone afin qu'elle descende.
Je disais que c'était plus commode parce que le temps avant la sonnerie des cours était compté. Mais là n'était pas la vraie raison.
En vérité, Kate m'impressionnait. Sa mère encore plus.
C'était une grande et belle femme avec du chien et de la classe. Quelque chose de sauvage et d'indépendant qui la rendait forte. Une voix qui portait loin et haut, à laquelle on n'avait d'autre
choix qu'obéir.
Par contraste, Kate semblait encore plus timide et effacée. Réservée par nature, elle parlait d'un ton
toujours doux, posé, conciliant. À la moindre émotion, sa peau blanche qui rosissait jusqu'aux oreilles trahissait son trouble.
Pourtant, Kate était loin, très loin d'être faible. De toutes mes amies, elle était même sûrement la plus forte.
Dès le premier appel de l'année, alors que nous n'étions pas encore
proches, j'en fus persuadée. Tandis que le prof égrenait nos noms un à un, la litanie des "Présent, M'sieur !" lui revenait en écho. Lorsqu'il arriva à Palinat Katherine, Kate ne moufta
pas. Croyant qu'elle n'avait pas entendu, je la poussai du coude.
- Palinat, Katherine, répéta le prof.
Silence.
Je dévisageai Kate interloquée. Pour moi débarquant d'un petit collège de province, habituée à
la discipline comme aux choux de Bruxelles à la cantine, ne pas répondre à un professeur était un acte de haute rebellion.
- Palinat, Katherine !
Bien qu'écarlate, ma future amie leva un doigt résolu.
- Palinat, Kate.
- Sur mon registre est inscrit Katherine.
- Peut-être, mais je m'appelle Kate.
Elle mentait, son vrai prénom était bien Katherine. Sauf que le détestant, elle l'avait rayé de sa vie pour revendiquer celui qu'elle s'était choisi.
De Katherine à Kate, la distinction peut paraître ténue, le combat peccadille, façon bataille d'ado ferraillant contre le choix de ses parents.
Il n'en était rien. En Katherine Kate ne se reconnaissait pas. Et tellement pas que troquer l'un pour
l'autre équivalait à une insulte.
Au mieux, cette méprise vous attirait un mutisme aussi poli que buté. Au pire, un rappel à l'ordre, son ordre, en bonne et due forme :
- Kate, je m'appelle Kate.
J'admirais sa résolution autant que sa personnalité. En apparence, Kate était lisse comme un lac. Mais en s'y penchant un
peu, à peine, les remous vous chaviraient.
Kate avait un calme trompeur d'avant tempête, une stabilité de baril de nytroglycérine n'attendant que l'allumette, une profondeur d'abysses qui m'échappaient.
À quatorze ans, je n'étais qu'une enfant.
À quatorze ans, Kate avait déjà vécu l'amour, la violence, la drogue, le suicide.
Sa pudeur lui interdisait de me les raconter. À moins que son ultra-sensibilité n'ait saisi, avant moi, que je ne pourrais les comprendre. Non parce que je la jugerais, mais parce que le fil de
nos histoires s'était dévidé sur deux planètes.
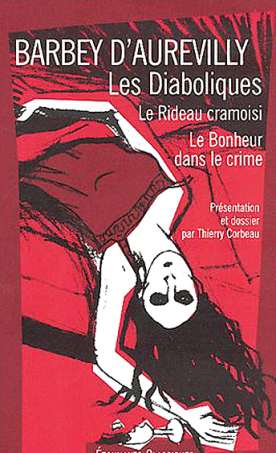 Peut-être la maturité des jeunes précoces avait-elle donné à
Kate sa faculté d'analyse. Parler sérieusement avec elle n'était jamais superficiel. Plissant les yeux, elle écartait l'accessoire d'un geste pour filer droit au cœur du problème, pulvérisant vos
barricades savamment dressées.
Peut-être la maturité des jeunes précoces avait-elle donné à
Kate sa faculté d'analyse. Parler sérieusement avec elle n'était jamais superficiel. Plissant les yeux, elle écartait l'accessoire d'un geste pour filer droit au cœur du problème, pulvérisant vos
barricades savamment dressées.
Autant dire qu'en une simple phrase, votre paravent éclatait pour vous mettre à poil. Mais jamais Kate n'en
tirait avantage. Pas question de jubiler de vous cerner - pire, de vous débusquer - en se félicitant de sa clairvoyance.
Au contraire, son tact rendait acceptables - ou mieux, désirables - les plus cruelles vérités.
Qui peut prétendre progresser sans être renvoyé à soi-même, confronté sans complaisance à ses leurres et contradictions ?
Avant Kate, je pensais en toute naïveté :
"Si tu m'aimes, approuve-moi".
En la côtoyant, je découvris qu'aimer n'était pas pas forcément prendre mon parti :
"Si tu m'aimes, approuve-moi quand j'ai raison, mais dis-moi quand j'ai tort. C'est le plus grand service que tu puisses me rendre."
Aujourd'hui, je le sais, j'ai moi-même du mal à appliquer ce service que je réclame. Pour des raisons qui me sont propres mais aussi de crainte de les
blesser ceux que j'aime.
Je n'ai pas, loin s'en faut, le tact de Kate.
Mais cela même est encore une autre histoire.
Au lycée, je changeai d'école. Kate et moi nous étions juré de ne point nous perdre de vue. Le temps se chargea de diluer notre promesse jusqu'à un lundi midi, deux ans plus tard.
C'était un premier cours de littérature française à la Sorbonne. Sur La Curée de Balzac, je m'en souviens.
Arrivant en retard, j'ouvris la porte à la volée. Les étudiants étaient déjà assis. Parmi eux, comme isolé par un zoom de cinéma, le visage de Kate apparut en gros plan, pile comme dans mon
souvenir.
Elle avait toujours sa peau blanche, ses yeux de chat et son sourire sybillin.
Je fis déplacer la rangée entière pour m'installer à ses côtés.
La planète inconnue de Kate et la mienne s'étaient rencontrées.
Au cours des années suivantes, elles allaient fusionner et s'éloigner à nouveau. Kate suivait un cursus que je finis par rejoindre. Nous passâmes les concours d'enseignement en même temps.
Je réussis alors même qu'elle devait me surclasser.
Son échec ne tint pas à un défaut de travail ou de brio, mais à une négligence : Kate, croyant emporter son brouillon à l'issue d'une épreuve, repartit avec sa copie.
Elle aurait voulu se saborder qu'elle n'aurait pu mieux faire.






















 Notre amitié commença dans ce café. Amitié réelle mais
lointaine par ma faute. Pas assez de temps, trop de travail, trop de voyages... Laurence et moi ne nous fréquentions que par à-coups.
Notre amitié commença dans ce café. Amitié réelle mais
lointaine par ma faute. Pas assez de temps, trop de travail, trop de voyages... Laurence et moi ne nous fréquentions que par à-coups.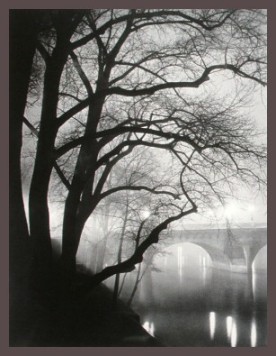



 Il y a deux
ans,
Il y a deux
ans,  I
I
 Voilà qu’elle arrive devant l’immeuble.
Voilà qu’elle arrive devant l’immeuble. Une fois "là-bas", je
retrouverai l'alignement des maisons sans âme, les quartiers frileusement resserrés sur leurs rues sans charme. Le centre-ville et ses immeubles de pierres grises, si accordés à la couleur du ciel.
Les mornes
Une fois "là-bas", je
retrouverai l'alignement des maisons sans âme, les quartiers frileusement resserrés sur leurs rues sans charme. Le centre-ville et ses immeubles de pierres grises, si accordés à la couleur du ciel.
Les mornes
Derniers Commentaires